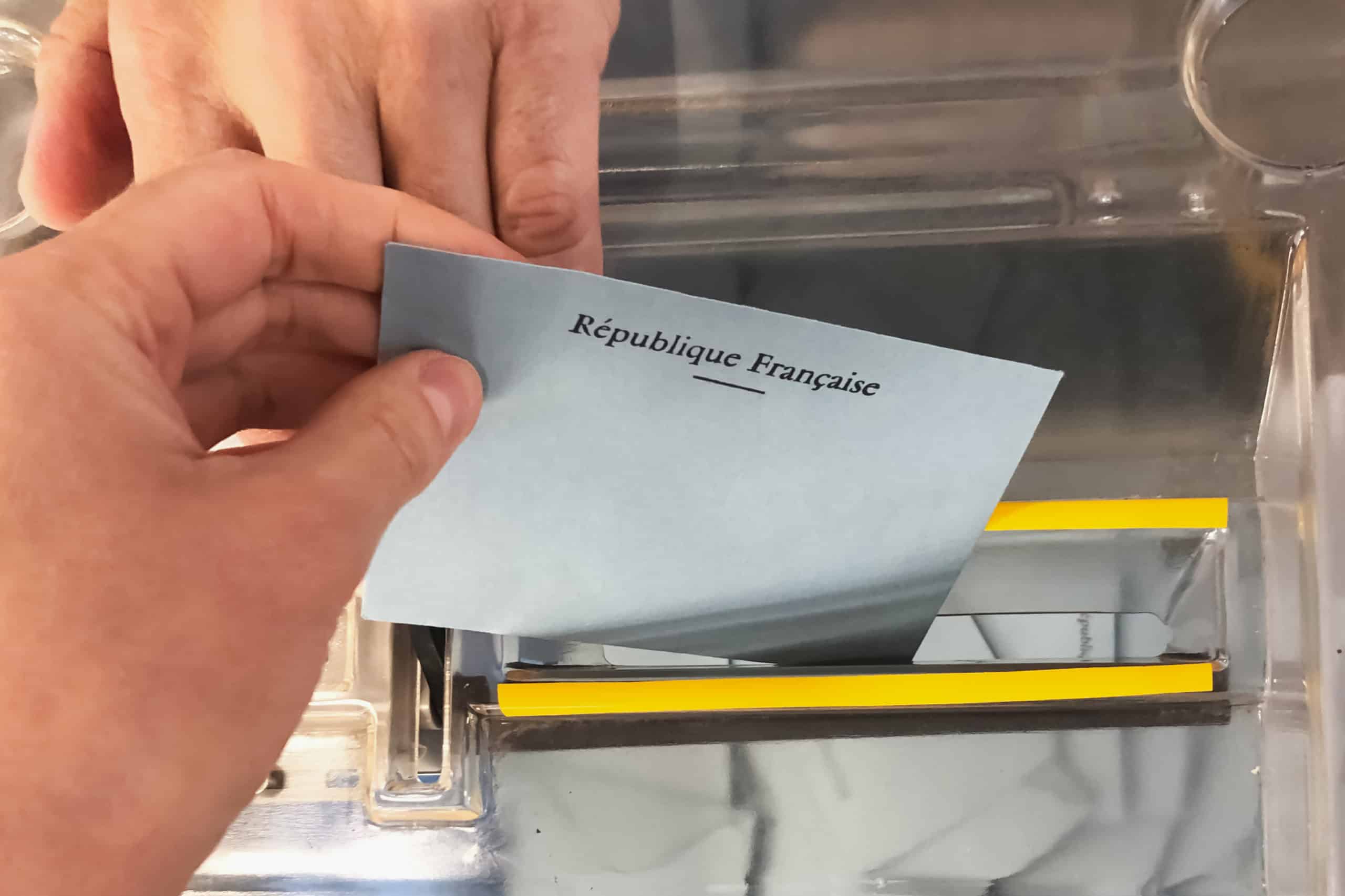Les émeutes racistes et islamophobes qui ont fait couler tant d’encre au Royaume-Uni et dans le monde sont saisissantes. Quiconque est lucide quant à l’engrenage semble-t-il implacable entraînant les sociétés européennes au bord du précipice ne peut cependant être surpris quant à ses émeutes. Elles ne sont que l’aboutissement en bout de chaîne d’un processus sociohistorique aussi limpide que prévisible. En surface, l’engrenage se présente comme suit. Un crime atroce est commis. Son auteur n’est pas encore connu, mais des voix assurées ont tôt fait d’accuser l’étranger, le musulman, le fourbe ennemi qui corrompt la société de l’intérieur. Qu’importe que l’identité finalement révélée du meurtrier ne corrobore en rien la rumeur, qu’il soit né au Royaume-Uni de parents chrétiens, que tous ceux qui l’ont connu l’ont décrit comme parfaitement intégré, sans que cela n’empêche en rien le passage à l’acte violent. La mécanique qui s’est enclenchée est déjà autonome de tout fondement, de toute justification. Les commerces brûlent, des barrages sont établis, ne laissant passer que les Blancs, lynchant les autres, mosquées et cimetières musulmans sont attaqués, en plus des innombrables propriétés privées de ceux que la rumeur a accusés. De nombreuses thèses de sociologie et d’anthropologie seront nécessaires pour nous renseigner quant à la sauvagerie qui s’est déchaînée au Royaume-Uni. Il est de grande nécessité d’expliquer la barbarie raciste, et de tenter de la conjurer en se donnant des prises réflexives quant à l’engrenage sociohistorique qui y aboutit. À ce titre, une piste parait offerte par l’usage correct de la notion de décivilisation proposée par Norbert Elias à l’examen de la barbarie nazie. Selon ce sociologue, la décivilisation n’est pas l’inverse du procès de civilisation ; elle est en un contrecoup pathologique, figuré par le détachement généralisé à l’égard des règles communes de comportement. Ces règles ne sont pourtant pas méconnues des acteurs, ils font le choix de les mépriser. Cet effondrement civilisationnel n’a rien de spontané, il ne se produit qu’à la condition de la diffusion au sein de la société entière d’affects brutaux, de comportements vulgaires, de mensonges éhontés. Selon Norbert Elias, la source historique de ces maux sociaux est à rechercher parmi les élites politiques, économiques et médiatiques qui, dans les sociétés modernes, offrent (du fait des aspirations à l’ascension sociale que chacun et chacune éprouve) un puissant modèle de comportement. Or, la leçon d’Elias est sans appel : l’inconséquence de la bourgeoisie aboutit au pire, ce dont convainc la violence féroce qui éclate aujourd’hui au grand jour. Au sein du débat public francophone, la barbarie raciste est pourtant reçue avec une singulière mansuétude. Telle sociologue française d’importance redira que la décivilisation britannique signe la fin du modèle multiculturel. Tel média conservateur mais désormais central au sein du débat public français sera plus explicite encore, affirmant que les émeutes islamophobes manifestent le problème musulman des sociétés européennes, inversant ainsi les victimes et leurs bourreaux. À nouveau, rien d’étonnant ne se découvre à la lumière des émeutes racistes qui ont secoué le Royaume-Uni. On y retrouve ainsi les symptômes de la crise longue dans laquelle sont plongées les sociétés européennes en proie aux plus inquiétantes pathologies collectives. C’est par la propagation généralisée de la brutalité et du mensonge que la décivilisation advient, et avec elle les violences les plus graves. Aussi le Collectif contre l’islamophobie en Europe appelle-t-il à un surcroît de réflexivité. La pente qui mène à la catastrophe n’a rien d’inéluctable. Pour être renversée, elle requiert néanmoins le courage des forces vives de nos sociétés.